Randonnée au cœur des Cévennes |

 Départ matinal sous le grand soleil. Le beau temps s'installe. Au sortir de La Bastide-Puylaurent, le Chemin Stevenson regagne bien vite les grands espaces
aériens de la forêt de la Gardille, parcourue déjà l'avant-veille. Le vent balaie le plateau et sa musique lugubre imprègne cette vaste solitude; à quoi tient-il donc qu'un jour celle-ci
exalte, que le lendemain, elle angoisse ? Le chemin Stevenson retrouve la vallée pour une ultime
rencontre avec l'Allier, tout jeunet. Le Chassezac aussi y creuse ses premiers méandres. Quelques hameaux s'égrènent le long du
val. Je garde surtout les souvenirs d'une jolie combe tapissée de narcisses et de l'église romane de Chasseradès, robuste et harmonieuse...
Inaccessible, hélas, comme bien d'autres ! Effet de notre époque de vandalisme et d'insécurité ; ces fléaux urbains frappent donc jusqu'au profond de pays reculés, qu'on croirait
préservés. Ah ! le bienheureux curé de Chanteuges qui, envers et contre tout, maintient l'hospitalité de son admirable abbatiale et la rehausse même de musique sacrée !
Départ matinal sous le grand soleil. Le beau temps s'installe. Au sortir de La Bastide-Puylaurent, le Chemin Stevenson regagne bien vite les grands espaces
aériens de la forêt de la Gardille, parcourue déjà l'avant-veille. Le vent balaie le plateau et sa musique lugubre imprègne cette vaste solitude; à quoi tient-il donc qu'un jour celle-ci
exalte, que le lendemain, elle angoisse ? Le chemin Stevenson retrouve la vallée pour une ultime
rencontre avec l'Allier, tout jeunet. Le Chassezac aussi y creuse ses premiers méandres. Quelques hameaux s'égrènent le long du
val. Je garde surtout les souvenirs d'une jolie combe tapissée de narcisses et de l'église romane de Chasseradès, robuste et harmonieuse...
Inaccessible, hélas, comme bien d'autres ! Effet de notre époque de vandalisme et d'insécurité ; ces fléaux urbains frappent donc jusqu'au profond de pays reculés, qu'on croirait
préservés. Ah ! le bienheureux curé de Chanteuges qui, envers et contre tout, maintient l'hospitalité de son admirable abbatiale et la rehausse même de musique sacrée !
 L'après-midi, ce sera encore une grande errance à travers les vallonnements de la montagne du Goulet et son immense forêt de résineux. Sur le versant méridional, j'assiste à
une nouvelle naissance, le Lot y voit le jour au cour du massif forestier et prend ses premiers ébats dans un joli val, salué par les bouleaux, les genêts et les narcisses. Trois destins bien divers pour trois cours d'eau nés au cour du
même massif; l'Allier unit sa destinée à la Loire et finit sa longue course aux confins de Bretagne ; le Chassezac avec l'Ardèche sinuent dans la profondeur de gorges sauvages, en route vers les
rivages méditerranéens ; et le Lot s'en va grossir la Garonne pour côtoyer les riches vignobles bordelais voisins de l'Atlantique. Hasard d'un vallon, d'une colline et les destins
divergent. Ainsi en va-t-il des enfants d'un même foyer. Etape de 25 km
L'après-midi, ce sera encore une grande errance à travers les vallonnements de la montagne du Goulet et son immense forêt de résineux. Sur le versant méridional, j'assiste à
une nouvelle naissance, le Lot y voit le jour au cour du massif forestier et prend ses premiers ébats dans un joli val, salué par les bouleaux, les genêts et les narcisses. Trois destins bien divers pour trois cours d'eau nés au cour du
même massif; l'Allier unit sa destinée à la Loire et finit sa longue course aux confins de Bretagne ; le Chassezac avec l'Ardèche sinuent dans la profondeur de gorges sauvages, en route vers les
rivages méditerranéens ; et le Lot s'en va grossir la Garonne pour côtoyer les riches vignobles bordelais voisins de l'Atlantique. Hasard d'un vallon, d'une colline et les destins
divergent. Ainsi en va-t-il des enfants d'un même foyer. Etape de 25 km
J'aborde aujourd'hui le « pays des Camisards ». Enfin, dirais-je ; mon attachement aux Cévennes n'est pas étranger à ma sympathie pour ces irréductibles défenseurs de leur foi. Quittant Le Bleymard et la vallée du Lot, le sentier escalade le versant septentrional du mont Lozère. Ascension assez banale jusque la station du Mont Lozère (1421 m.). On atteint alors le désert sommital, et l'on grimpe le long de la draille (Les drailles sont probablement les plus anciennes voies de communication à travers les Cévennes. Si elles font aujourd'hui le bonheur des randonneurs, pendant de nombreux siècles, elles ont servi de voies de transhumance pour les troupeaux de moutons, surtout, qui montaient des plaines méridionales vers le causse Méjean, le Larzac, le Tanargue, le Lozère... Pierre A. Clement leur a consacré un livre passionnant, « En Cévennes avec les bergers ».
 Cet historien du Languedoc a parcouru cinq de ces itinéraires mythiques
en compagnie des bergers. Et il décrit cette expérience dans des récits savoureux, où les randonneurs qui ont sillonné les Cévennes retrouveront bien des lieux marquants.) jalonnée
de « montjoies » (Les « montjoies » sont de hautes bornes de granite, comme celles qui jalonnent la draille sur le mont Lozère, ou des assemblages de pierres. Leur fonction la plus évidente est de baliser les itinéraires de transhumance et autres, à la manière
des « cairns » que connaissent bien les randonneurs, particulièrement dans les Pyrénées. Mais, signale le topo-guide, certaines « montjoies » dateraient du moyen âge et auraient
délimité des domaines. Ainsi les croix de Malte sculptées sur certaines pierres dressées du Lozère auraient borné les biens des chevaliers de Malte... J'y ai surtout remarqué les
« tags » iconoclastes !). C'est le royaume du vent, qui balaie la lande de cailloux et d'herbe rase. Le randonneur s'arc-boute jusqu'au sommet du pic Finiels (1699 m.) C'est le point culminant du
massif et de ma randonnée. Tout à l'entour, l'infinie ondulation des crêtes et des vallées s'estompe dans une brume bleutée; au Nord, la mémoire relit les étapes récentes ; au Sud, l'imagination
entrevoit les cheminements prochains. Et l'esprit vagabonde dans cette haute solitude (partagée le temps d'une halte, car la randonneuse d'outre-Rhin m'y a rejoint).
Cet historien du Languedoc a parcouru cinq de ces itinéraires mythiques
en compagnie des bergers. Et il décrit cette expérience dans des récits savoureux, où les randonneurs qui ont sillonné les Cévennes retrouveront bien des lieux marquants.) jalonnée
de « montjoies » (Les « montjoies » sont de hautes bornes de granite, comme celles qui jalonnent la draille sur le mont Lozère, ou des assemblages de pierres. Leur fonction la plus évidente est de baliser les itinéraires de transhumance et autres, à la manière
des « cairns » que connaissent bien les randonneurs, particulièrement dans les Pyrénées. Mais, signale le topo-guide, certaines « montjoies » dateraient du moyen âge et auraient
délimité des domaines. Ainsi les croix de Malte sculptées sur certaines pierres dressées du Lozère auraient borné les biens des chevaliers de Malte... J'y ai surtout remarqué les
« tags » iconoclastes !). C'est le royaume du vent, qui balaie la lande de cailloux et d'herbe rase. Le randonneur s'arc-boute jusqu'au sommet du pic Finiels (1699 m.) C'est le point culminant du
massif et de ma randonnée. Tout à l'entour, l'infinie ondulation des crêtes et des vallées s'estompe dans une brume bleutée; au Nord, la mémoire relit les étapes récentes ; au Sud, l'imagination
entrevoit les cheminements prochains. Et l'esprit vagabonde dans cette haute solitude (partagée le temps d'une halte, car la randonneuse d'outre-Rhin m'y a rejoint).
 Mais nos itinéraires se quittent aussitôt. Le GR®70 n'est plus qu'une descente quasi ininterrompue vers Finiels et le Pont-de-Montvert. C'est une fin d'étape un peu rapide... et frustrante : il fait grand beau temps ; et il y a quelques années, au cours d'une randonnée
pascale, je me suis promis de revenir admirer la floraison des genêts du Lozère. L'occasion est trop belle. Je ne résiste pas à une longue boucle par le « GR®7 ». Après le col de Finiels, la draille du Languedoc, est un peu longuette sur l'ancienne voie romaine ; mais quel enchantement quand
l'étroit sentier bascule sur le versant méridional du massif, il dévale le long d'un ruisseau, serpente entre les blocs de granite et se faufile dans l'or des genêts...
Mais nos itinéraires se quittent aussitôt. Le GR®70 n'est plus qu'une descente quasi ininterrompue vers Finiels et le Pont-de-Montvert. C'est une fin d'étape un peu rapide... et frustrante : il fait grand beau temps ; et il y a quelques années, au cours d'une randonnée
pascale, je me suis promis de revenir admirer la floraison des genêts du Lozère. L'occasion est trop belle. Je ne résiste pas à une longue boucle par le « GR®7 ». Après le col de Finiels, la draille du Languedoc, est un peu longuette sur l'ancienne voie romaine ; mais quel enchantement quand
l'étroit sentier bascule sur le versant méridional du massif, il dévale le long d'un ruisseau, serpente entre les blocs de granite et se faufile dans l'or des genêts...
La draille poursuit sa descente paisible par les vieux hameaux déserts (Salarial, l'Hôpital) et atteint le Pont-du-Tarn. Le site est à la hauteur de mon souvenir et mieux encore au cour du printemps, l'eau limpide miroite et chante sur les rochers. Mon casse-croûte est un moment idyllique de ma randonnée. Maintenant, je bifurque sur le GR72 qui n'a rien à envier au GR7, pendant quelques km, il borde la rivière qui se précipite en torrent à travers des éboulis rocheux. Et le sentier se met lui aussi à dégringoler dans des massifs de genêts hérissés de chaos granitiques. Felgerolles, le Merlet... et puis l'enchantement disparaît sur la départementale menant au Pont-de-Montvert. Une petite demi-heure d'asphalte, ce n'est pas trop cher payer une longue course jubilatoire. Etape de 30 km
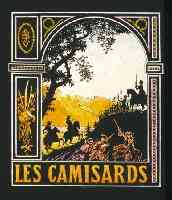 Le Pont-de-Montvert, c'est un haut lieu du « pays camisard ». Le temple, où trône une chaire en bois d'une majestueuse simplicité, atteste encore de la vivacité de la foi
réformée. Mais comment imaginer que ce beau et paisible village a été, en 1702, le berceau de ces événements dramatiques (l'assassinat de l'abbé du Chayla et ensuite l'exécution du principal meneur,
Pierre Séguier) qui ont déclenché une guerre si terrible ? (C'est le 24 juillet 1702 que l'abbé du Chayla fut assassiné au Pont-de-Montvert par une troupe de protestants, venus réclamer la
libération de leurs coreligionnaires.
Le Pont-de-Montvert, c'est un haut lieu du « pays camisard ». Le temple, où trône une chaire en bois d'une majestueuse simplicité, atteste encore de la vivacité de la foi
réformée. Mais comment imaginer que ce beau et paisible village a été, en 1702, le berceau de ces événements dramatiques (l'assassinat de l'abbé du Chayla et ensuite l'exécution du principal meneur,
Pierre Séguier) qui ont déclenché une guerre si terrible ? (C'est le 24 juillet 1702 que l'abbé du Chayla fut assassiné au Pont-de-Montvert par une troupe de protestants, venus réclamer la
libération de leurs coreligionnaires.
L'abbé du Chayla, ancien curé de St-Germain-de-Calberte, condamné par l'Eglise pour concussion, s'était cependant vu promu grâce à ses relations familiales et politiques. Il avait ainsi en charge, entre autres tâches, l'évangélisation « musclée » des Cévennes. Son zèle brutal suscita la haine des Protestants... qui connut son paroxysme ce funeste soir de juillet 1702. Rapidement arrêté et jugé comme meneur des meurtriers, Pierre Séguier, surnommé Esprit Séguier pour ses prêches inspirés, fut condamné à avoir le poing sectionné et à être brûlé vif à l'endroit même où sa victime avait péri, c'est-à-dire devant la tour de l'Horloge du Pont-de-Montvert. Ainsi débutait une guerre terrible qui allait mettre les Cévennes à feu et à sang, deux ans durant. Jean-Pierre Chabrol a évoqué ces années terribles dans un très beau roman intitulé « Les Fous de Dieu ». Une phrase seulement: « Je bus, les lèvres dans la mousse du ruisselet, ce tandis que mon âme se désaltérait de la pureté de s'agenouiller ainsi, dans le cresson d'une source plutôt que sur le prie-dieu d'un saint-Joseph de craie, et de baiser l'eau des neiges plutôt que la bague d'un évêque..
 L'étape du jour du GR70 ne respecte pas l'itinéraire historique vers Florac. « Une route neuve, écrit le romancier, conduit
de Pont-de-Montvert à Florac, par la vallée du Tarn. Son assise de sable doux se développe environ à mi-chemin entre le faîte des monts et la rivière au fond de la vallée. » (R.L.
Stevenson, « Voyage avec un âne dans les Cévennes ». C'est aujourd'hui la D. 998 qui sinue le long du Tarn. Pas question pour un randonneur d'endurer une
vingtaine de km d'asphalte et de circulation routière ! Le GR70, lui, offre aux émules de Stevenson la solitude et les paysages de l'altitude. A peine sorti du Pont-de-Montvert par une belle calade, la Cham de L'Hermet surplombe la bourgade étirée dans son creux de collines au confluent du Lot, du Rieumalet et du Martinet.
Et puis au flanc du Bougès, c'est l'ascension dans une cathédrale de conifères, au son des grandes orgues d'Eole. Au col de la Planette débute le long cheminement sur l'échine bosselée de la
montagne du Bougès. Elle culmine au Signal du Bougès (1421 m.), dont le dôme est ponctué d'un cairn monumental. C'est un belvédère magnifique. Je tiens ma revanche sur cette épouvantable journée
d'avril 95, qui ne fut qu'une course ininterrompue; pluie et brouillard effaçaient tous ces paysages offerts aujourd'hui sous un ciel azuréen du mont Lozère à la vallée de la Mimente en passant par
les falaises du Méjean. Ces deux derniers jours, j'ai atteint les sommets (géographique, esthétique et mental) de mon équipée. Ah ! pouvoir prolonger cet état de liberté, de sérénité, de
paix... Au terme de cette belle course, les terrasses de Florac ombragées de platanes ont un charme très méridional, à deux pas de la source du Pêcher... Etape de 25 km.
L'étape du jour du GR70 ne respecte pas l'itinéraire historique vers Florac. « Une route neuve, écrit le romancier, conduit
de Pont-de-Montvert à Florac, par la vallée du Tarn. Son assise de sable doux se développe environ à mi-chemin entre le faîte des monts et la rivière au fond de la vallée. » (R.L.
Stevenson, « Voyage avec un âne dans les Cévennes ». C'est aujourd'hui la D. 998 qui sinue le long du Tarn. Pas question pour un randonneur d'endurer une
vingtaine de km d'asphalte et de circulation routière ! Le GR70, lui, offre aux émules de Stevenson la solitude et les paysages de l'altitude. A peine sorti du Pont-de-Montvert par une belle calade, la Cham de L'Hermet surplombe la bourgade étirée dans son creux de collines au confluent du Lot, du Rieumalet et du Martinet.
Et puis au flanc du Bougès, c'est l'ascension dans une cathédrale de conifères, au son des grandes orgues d'Eole. Au col de la Planette débute le long cheminement sur l'échine bosselée de la
montagne du Bougès. Elle culmine au Signal du Bougès (1421 m.), dont le dôme est ponctué d'un cairn monumental. C'est un belvédère magnifique. Je tiens ma revanche sur cette épouvantable journée
d'avril 95, qui ne fut qu'une course ininterrompue; pluie et brouillard effaçaient tous ces paysages offerts aujourd'hui sous un ciel azuréen du mont Lozère à la vallée de la Mimente en passant par
les falaises du Méjean. Ces deux derniers jours, j'ai atteint les sommets (géographique, esthétique et mental) de mon équipée. Ah ! pouvoir prolonger cet état de liberté, de sérénité, de
paix... Au terme de cette belle course, les terrasses de Florac ombragées de platanes ont un charme très méridional, à deux pas de la source du Pêcher... Etape de 25 km.
 Ce
dimanche matin, Florac sommeille encore quand je parcours
ses ruelles désertes. C'est que, vers St-Germain-de-Calberte, j'ai de
nouveau une solide étape. Bien vite, avec le GR70, je tourne le dos aux falaises du causse Méjean et je
m'engage dans la vallée de la Mimente. L'altitude progressive et la forêt
effacent les vrombissements de la circulation motorisée. Me revoilà dans
la grande nature, au cour de la Cévenne des châtaigniers. Les troncs
robustes et noueux, aux formes sculpturales, colonisent les versants des
collines. Surprise autant que moi, une biche détale dans un fracas de
branches. A St-Julien-d'Arpaon, je redescends
traverser la rivière et j'entame alors un long cheminement, paisible et charmant, sur
l'ancienne voie ferrée; aujourd'hui, c'est un plaisant chemin herbeux et fleuri
qui épouse les méandres de la vallée en surplomb du ruban émeraude de la
Mimente. À Cassagnas, le temps
est radieux ; et incite au farniente... Pourquoi se presser alors qu'il ne reste
guère qu'une bonne dizaine de bornes ? Mais il faut tout de
même « y aller » et regagner la hauteur des collines. Le chemin regrimpe dans la forêt ; la pente est
confortable et ne contrarie pas l'agrément de la marche. La stèle élevée à
la mémoire des Camisards au Plan de Fontmort mérite bien un petit détour sur le « GR®7 - GR®67 » venant de Barre-des-Cévennes. « Non loin de cet endroit, sur ma droite, se dressait le fameux Plan de Font
Morte où Poul, avec son cimeterre arménien, trucidait les Camisards de Séguier ».
Ce
dimanche matin, Florac sommeille encore quand je parcours
ses ruelles désertes. C'est que, vers St-Germain-de-Calberte, j'ai de
nouveau une solide étape. Bien vite, avec le GR70, je tourne le dos aux falaises du causse Méjean et je
m'engage dans la vallée de la Mimente. L'altitude progressive et la forêt
effacent les vrombissements de la circulation motorisée. Me revoilà dans
la grande nature, au cour de la Cévenne des châtaigniers. Les troncs
robustes et noueux, aux formes sculpturales, colonisent les versants des
collines. Surprise autant que moi, une biche détale dans un fracas de
branches. A St-Julien-d'Arpaon, je redescends
traverser la rivière et j'entame alors un long cheminement, paisible et charmant, sur
l'ancienne voie ferrée; aujourd'hui, c'est un plaisant chemin herbeux et fleuri
qui épouse les méandres de la vallée en surplomb du ruban émeraude de la
Mimente. À Cassagnas, le temps
est radieux ; et incite au farniente... Pourquoi se presser alors qu'il ne reste
guère qu'une bonne dizaine de bornes ? Mais il faut tout de
même « y aller » et regagner la hauteur des collines. Le chemin regrimpe dans la forêt ; la pente est
confortable et ne contrarie pas l'agrément de la marche. La stèle élevée à
la mémoire des Camisards au Plan de Fontmort mérite bien un petit détour sur le « GR®7 - GR®67 » venant de Barre-des-Cévennes. « Non loin de cet endroit, sur ma droite, se dressait le fameux Plan de Font
Morte où Poul, avec son cimeterre arménien, trucidait les Camisards de Séguier ».
 C'est donc là que le capitaine Poul surprit
« Esprit » Séguier et sa troupe de Camisards. À l'issue du combat, le meurtrier
de l'abbé du Chayla fut capturé par les soldats du roi et emmené à Florac pour y être jugé. Ce site
historique est ainsi consacré par une stèle, un modeste obélisque qui commémore
l'héroïque attachement des huguenots cévenols à la foi réformée.
Le romancier écossais se
laisse aller, par ailleurs, à des réflexions judicieuses: "Je pensais en
souriant à Baville et à ses dragons, et qu'on peut bien fouler une religion sous
les rudes sabots des chevaux pendant un siècle et ne la laisser que plus vivante
après cette épreuve. L'Irlande
est toujours catholique; les Cévennes sont toujours protestantes. Une pleine
corbeillée de lois et de décrets, non plus que les sabots et gueules de canons
d'un régiment de cavalerie ne peuvent modifier d'un iota la liberté de penser
d'un laboureur...". Le « GR®70 » leur emboîte maintenant le pas le long de l'ancienne route royale qui
s'élève à flanc de collines. Cette voie stratégique a été tracée et taillée à
même le versant schisteux pour le déplacement des troupes au cour de la montagne
cévenole. A présent ce beau chemin en corniche a une vocation plus
pacifique; tout au long de ce belvédère, le randonneur jouit d'un un
spectacle permanent, le panorama est immense vers les crêtes onduleuses des
serres qui se succèdent, par-delà le dédale des gardons, jusque l'horizon
bleuté de l'Aigoual. Dans cette fin d'après-midi méridionale, la forêt
embaume un chaud parfum de résine... Etape
de 28 km
C'est donc là que le capitaine Poul surprit
« Esprit » Séguier et sa troupe de Camisards. À l'issue du combat, le meurtrier
de l'abbé du Chayla fut capturé par les soldats du roi et emmené à Florac pour y être jugé. Ce site
historique est ainsi consacré par une stèle, un modeste obélisque qui commémore
l'héroïque attachement des huguenots cévenols à la foi réformée.
Le romancier écossais se
laisse aller, par ailleurs, à des réflexions judicieuses: "Je pensais en
souriant à Baville et à ses dragons, et qu'on peut bien fouler une religion sous
les rudes sabots des chevaux pendant un siècle et ne la laisser que plus vivante
après cette épreuve. L'Irlande
est toujours catholique; les Cévennes sont toujours protestantes. Une pleine
corbeillée de lois et de décrets, non plus que les sabots et gueules de canons
d'un régiment de cavalerie ne peuvent modifier d'un iota la liberté de penser
d'un laboureur...". Le « GR®70 » leur emboîte maintenant le pas le long de l'ancienne route royale qui
s'élève à flanc de collines. Cette voie stratégique a été tracée et taillée à
même le versant schisteux pour le déplacement des troupes au cour de la montagne
cévenole. A présent ce beau chemin en corniche a une vocation plus
pacifique; tout au long de ce belvédère, le randonneur jouit d'un un
spectacle permanent, le panorama est immense vers les crêtes onduleuses des
serres qui se succèdent, par-delà le dédale des gardons, jusque l'horizon
bleuté de l'Aigoual. Dans cette fin d'après-midi méridionale, la forêt
embaume un chaud parfum de résine... Etape
de 28 km
 St-Germain-de-Calberte a érigé, sur sa placette, un surprenant monument pour célébrer la mémoire des
Cévenols qui ont inlassablement modelé le paysage de leurs montagnes. On
comprend mieux, à les parcourir, le labeur fourni pour y tracer les routes
et convertir les flancs abrupts à la culture en y aménageant les « bancels » ou
« faïsses » (André Chamson raconte, dans « Les Hommes de la route »,
le dur labeur des paysans qui louaient leurs bras pour construire les routes
dans la montagne, histoire d'assurer un petit supplément à leurs maigres ressources.
« Suite cévenole », Libr. Plon. 1968. Et J. P. Chabrol évoque
l'édification des
« bancels » ou « faïsses », ces terrasses de culture: « Quand
on voit les travaux exécutés par nos arrière-grands-pères, on reste abasourdi
par la somme de peines, de patience et de sueur qu'ils ont dû exiger. Pour fabriquer de toutes pièces ces lopins en
couloir, il a fallu arracher des rochers, apporter de la rivière les pierres de
soutènement, charrier la terre dans les « banastous » (les paniers ) pour
combler le vide. Tout ça pour planter trois ou quatre ceps de plus. (...)
J'ai vu un paysan construire un mur de pierres sèches de quarante mètres de long
sur deux à trois de hauteur et combler le vide avec de la terre portée sur le
dos. (...) Je comprenais l'attachement fou du Cévenol à son bien.
St-Germain-de-Calberte a érigé, sur sa placette, un surprenant monument pour célébrer la mémoire des
Cévenols qui ont inlassablement modelé le paysage de leurs montagnes. On
comprend mieux, à les parcourir, le labeur fourni pour y tracer les routes
et convertir les flancs abrupts à la culture en y aménageant les « bancels » ou
« faïsses » (André Chamson raconte, dans « Les Hommes de la route »,
le dur labeur des paysans qui louaient leurs bras pour construire les routes
dans la montagne, histoire d'assurer un petit supplément à leurs maigres ressources.
« Suite cévenole », Libr. Plon. 1968. Et J. P. Chabrol évoque
l'édification des
« bancels » ou « faïsses », ces terrasses de culture: « Quand
on voit les travaux exécutés par nos arrière-grands-pères, on reste abasourdi
par la somme de peines, de patience et de sueur qu'ils ont dû exiger. Pour fabriquer de toutes pièces ces lopins en
couloir, il a fallu arracher des rochers, apporter de la rivière les pierres de
soutènement, charrier la terre dans les « banastous » (les paniers ) pour
combler le vide. Tout ça pour planter trois ou quatre ceps de plus. (...)
J'ai vu un paysan construire un mur de pierres sèches de quarante mètres de long
sur deux à trois de hauteur et combler le vide avec de la terre portée sur le
dos. (...) Je comprenais l'attachement fou du Cévenol à son bien.
Au gré des ruelles du village, on découvre d'ailleurs ces terrasses en escaliers qui s'accrochent aux versants pentus des collines. Maintenant que je m'achemine vers le terme de mon équipée, je quitte progressivement les crêtes aérées. Je redescends dans le dédale des torrents, les gardons comme on les appelle ici : j'ai surplombé le gardon de St-Germain, dépassé ses confluents avec le gardon de St-Martin de Lansuscle et puis le gardon de St-Etienne. À mesure la chaleur s'appesantit, lourde, orageuse. Mais les basses vallées restent bien encore terre huguenote; ainsi sur le bord du chemin, j'ai aperçu des tombes érigées dans un jardin particulier puisque les « hérétiques » étaient interdits de cimetière, ils enterraient leurs défunts dans le domaine familial.
 Le
col St-Pierre, après la rude et caniculaire grimpée du chemin royal, marque
l'entrée dans le
Gard. Ultime casse-croûte en Lozère, sous les châtaigniers géants du col,
avant de dévaler le sentier rocailleux vers St-Jean-du-Gard. J'apprécie donc
cette dernière navigation à travers la houle figée des serres, dans cet océan
de verdures (vert tendre des châtaigniers, vert sombre des pins) nimbé de
brume bleutée. Y surnagent de très rares toits de tuiles rouges; navigateurs
solitaires ou naufragés à la dérive ?
Le
col St-Pierre, après la rude et caniculaire grimpée du chemin royal, marque
l'entrée dans le
Gard. Ultime casse-croûte en Lozère, sous les châtaigniers géants du col,
avant de dévaler le sentier rocailleux vers St-Jean-du-Gard. J'apprécie donc
cette dernière navigation à travers la houle figée des serres, dans cet océan
de verdures (vert tendre des châtaigniers, vert sombre des pins) nimbé de
brume bleutée. Y surnagent de très rares toits de tuiles rouges; navigateurs
solitaires ou naufragés à la dérive ?
Et voici St-Jean-du-Gard, la méridionale, étalée sur les rives du gardon, presque dans la plaine avec ses 189 m. d'altitude. Platanes et palmiers donnent aux terrasses une allure méditerranéenne. Etape de 22 km. 500. Je retrouve aujourd'hui mon entière solitude, Ursula est repartie vers les collines, Les Ayres, le col de Jalcreste et puis Florac encore. Adieu donc ! Au programme, une toute petite étape, essentiellement consacrée à la visite de deux musées. À St-Jean-du-Gard d'abord, celui « des Vallées Cévenoles » me rappelle singulièrement le « musée de la Vie Wallonne » à Liège en Belgique. C'est frappant d'y observer combien, à des centaines de km., la vie rurale d'antan usait d'outils et d'ustensiles si analogues; combien elle inspirait des gestes identiques.
 Mais, ici, je découvre aussi la place
majeure du châtaignier et du mûrier dans la civilisation cévenole. « L'arbre
à pain » en a été longtemps un élément vital : les châtaignes nourrissaient
hommes et bêtes; le bois servait de matériau de construction et le feuillage de
litière; les Camisards trouvaient même occasionnellement refuge dans leurs
troncs évidés. Pas étonnant que les
armées royales aient incendié la forêt cévenole pour affamer les Camisards et
les réduire à merci. Et le mûrier, encore au début du XXe siècle, assurera une
relative aisance dans les vallées méridionales grâce au « pactole » de la soie.
(Anna Rey raconte la vie de sa mère dans son livre « Augustine Rouvière,
Cévenole ». Et son héroïne confie : « Avant
la guerre de 1914, on n'était pas trop malheureux dans ma douce vallée.
C'était la Cévenne. (...) Oui, notre vallée était bonne ! Et puis il y avait
« les magnans ». C'était cela qui faisait sa richesse. C'était
toujours après la vente des cocons qu'on pouvait enfin payer ses contributions.
Tous les Cévenols plantèrent des mûriers et éduquèrent des vers à soie.
Les moignons tordus des mûriers se dressèrent vers le ciel d'hiver dans un
paysage où, peu à peu, ils vinrent remplacer les vignes. (...) Les bonnes années,
on faisait chez nous de trente à quarante kilos de cocons par once de graine et
ils nous étaient payés cent cinquante francs environ.
Mais, ici, je découvre aussi la place
majeure du châtaignier et du mûrier dans la civilisation cévenole. « L'arbre
à pain » en a été longtemps un élément vital : les châtaignes nourrissaient
hommes et bêtes; le bois servait de matériau de construction et le feuillage de
litière; les Camisards trouvaient même occasionnellement refuge dans leurs
troncs évidés. Pas étonnant que les
armées royales aient incendié la forêt cévenole pour affamer les Camisards et
les réduire à merci. Et le mûrier, encore au début du XXe siècle, assurera une
relative aisance dans les vallées méridionales grâce au « pactole » de la soie.
(Anna Rey raconte la vie de sa mère dans son livre « Augustine Rouvière,
Cévenole ». Et son héroïne confie : « Avant
la guerre de 1914, on n'était pas trop malheureux dans ma douce vallée.
C'était la Cévenne. (...) Oui, notre vallée était bonne ! Et puis il y avait
« les magnans ». C'était cela qui faisait sa richesse. C'était
toujours après la vente des cocons qu'on pouvait enfin payer ses contributions.
Tous les Cévenols plantèrent des mûriers et éduquèrent des vers à soie.
Les moignons tordus des mûriers se dressèrent vers le ciel d'hiver dans un
paysage où, peu à peu, ils vinrent remplacer les vignes. (...) Les bonnes années,
on faisait chez nous de trente à quarante kilos de cocons par once de graine et
ils nous étaient payés cent cinquante francs environ.
J'ai revu avec joie le beau pont des Camisards à Mialet, dont les arches élégantes enjambent les eaux cristallines du gardon. Mais après avoir parcouru ces collines où plane le souvenir omniprésent des Camisards, je souhaitais surtout visiter le « musée du Désert » au Mas Soubeyran. Dans ce hameau, la maison natale d'un chef fameux, Pierre Laporte, dit Rolland, a été ingénieusement aménagée en y intégrant quelques demeures contiguës. C'est ainsi le véritable mémorial du Protestantisme dans les Cévennes, qui manifeste un véritable culte à la Liberté. Les fiers Cévenols, exécutés comme hérétiques, ne voulaient même pas se satisfaire de la tolérance, simple concession à une conviction dédaignée. Ils revendiquaient ni plus ni moins la liberté de conscience, la liberté de croire et de manifester leur foi sur un parfait pied d'égalité. « Récister » (sic): c'est la devise gravée par une des cévenoles emprisonnées dans la fameuse tour d'Aigues-Mortes, pendant que leurs époux ramaient sur les galères royales. Son orthographe n'était pas à la hauteur de sa noblesse. Qu'importe ! cet idéal n'est pas un vain mot dans ces montagnes; pendant la seconde guerre, les maquis furent actifs dans les Cévennes, terre d'asile pour les dissidents allemands et autrichiens, de même que pour de très nombreux Juifs. Quelques habitants de St-Germain-de-Calberte ont ainsi mérité la « médaille des Justes ». Etape de 12 km
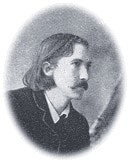 R.L.
Stevenson a quitté son ânesse Modestine à St-Jean-du-Gard. Et il a
gagné
Alès par la diligence. Je prolonge donc son périple. En avant pour
cette ultime étape ! Mais ce ne sera pas simplement une tranquille balade en
plaine. Par Mialet, je regagne les collines sur les
balises du GR67. Et au-delà des Aigladines, passé le col d'Uglas, le
GR44D entame un véritable parcours de montagnes russes sur une longue
échine bosselée. Pas loin de 700 à 800 m. de dénivelée à crapahuter dans
la garrigue; le sentier, rocailleux et tortueux comme j'en ai rarement
rencontré depuis Brioude, se faufile sur la crête du bois de Malabouisse, dans
un tunnel de chênes verts, de buis, de lauriers; il grimpe et dévale dans un
chaos de blocs calcaires. Immense
solitude; de toute la journée, pas la moindre présence dans la montagne. Tout au plus, l'un ou l'autre toits de tuile là-bas, au fin fond de la vallée du
Galeizon, estompée dans la brume d'une journée moite et orageuse. Solitude
un peu angoissante... Je touche au but, avec des sentiments mitigés. Avec
une pointe d'appréhension. Un accident, un incident stupide est toujours
possible dans cette caillasse, sur ce sentier chaotique. Et en même temps,
ai-je vraiment envie d'en finir avec cette randonnée au long cours ? Pas sûr... Je viens de terminer mon dernier casse-croûte sur
le sommet de Montcalm. Et là-bas dans la plaine m'apparaît l'agglomération
d'Alès, brumeuse mais bien réelle; encore une bonne heure pour redescendre de
ces chères montagnes. C'est une idée malencontreuse de terminer une
randonnée dans une grande cité. Premier bruit: une sirène de police;
première image: une immense H.L.M.. Brutal contact avec la fourmilière
humaine. Etape de 25 km.
R.L.
Stevenson a quitté son ânesse Modestine à St-Jean-du-Gard. Et il a
gagné
Alès par la diligence. Je prolonge donc son périple. En avant pour
cette ultime étape ! Mais ce ne sera pas simplement une tranquille balade en
plaine. Par Mialet, je regagne les collines sur les
balises du GR67. Et au-delà des Aigladines, passé le col d'Uglas, le
GR44D entame un véritable parcours de montagnes russes sur une longue
échine bosselée. Pas loin de 700 à 800 m. de dénivelée à crapahuter dans
la garrigue; le sentier, rocailleux et tortueux comme j'en ai rarement
rencontré depuis Brioude, se faufile sur la crête du bois de Malabouisse, dans
un tunnel de chênes verts, de buis, de lauriers; il grimpe et dévale dans un
chaos de blocs calcaires. Immense
solitude; de toute la journée, pas la moindre présence dans la montagne. Tout au plus, l'un ou l'autre toits de tuile là-bas, au fin fond de la vallée du
Galeizon, estompée dans la brume d'une journée moite et orageuse. Solitude
un peu angoissante... Je touche au but, avec des sentiments mitigés. Avec
une pointe d'appréhension. Un accident, un incident stupide est toujours
possible dans cette caillasse, sur ce sentier chaotique. Et en même temps,
ai-je vraiment envie d'en finir avec cette randonnée au long cours ? Pas sûr... Je viens de terminer mon dernier casse-croûte sur
le sommet de Montcalm. Et là-bas dans la plaine m'apparaît l'agglomération
d'Alès, brumeuse mais bien réelle; encore une bonne heure pour redescendre de
ces chères montagnes. C'est une idée malencontreuse de terminer une
randonnée dans une grande cité. Premier bruit: une sirène de police;
première image: une immense H.L.M.. Brutal contact avec la fourmilière
humaine. Etape de 25 km.
Je déguste une bière à la terrasse du « Mal Assis » dans la piétonnier d'Alès. Et la nostalgie déjà me prend. Ce sentiment n'est pas neuf au terme d'une grande randonnée. Mais je le ressens aujourd'hui avec une acuité particulière, la belle aventure est bien finie. Je vais retrouver les miens,... mais aussi toutes les contraintes quotidiennes. Ne pas perdre trop vite la mémoire des images, des sensations, le souvenir des émotions, l'exaltation de la pensée. « Résister » à l'usure du quotidien; la liberté n'est-elle pas plus dans la tête et le cœur que dans l'air des montagnes ? par Jean Marie Maquet
Ancien hôtel de villégiature avec un jardin au bord de l'Allier, L'Etoile Maison d'hôtes se situe à La Bastide-Puylaurent entre la Lozère, l'Ardèche et les Cévennes dans les montagnes du Sud de la France. Au croisement des GR®7, GR®70 Chemin Stevenson, GR®72, GR®700 Voie Régordane, GR®470 Sources et Gorges de l'Allier, GRP® Cévenol, Montagne Ardéchoise, Margeride. De nombreux itinéraires en boucle pour des randonnées et des sorties à vélo d'une journée. Idéal pour un séjour de détente et de randonnée.
Copyright©etoile.fr